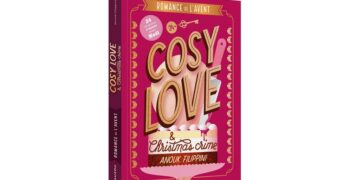À l’intérieur de ses séries diversement intitulées, l’OSM offrait aux abonnés
montréalais ce concert du 6 mai annonçant un retour à l’interprétation du légendaire
pianiste américain Léon Fleischer accompagné dans une magnifique oeuvre de sérénité
de Mozart (le Concerto pour piano en la majeur K.414) par l’Orchestre symphonique de
Toronto dirigé par le sympathique Peter Oundjian. Mais qui était-il donc ce Léon
Fleischer, avant que sa main droite ne subisse les foudres dégénératives de la
dystonie focale? Eh bien, rien de moins qu’un des cinq plus grands interprètes de
tous les temps des infiniment difficiles oeuvres pour piano de Johannes Brahms. De
Fleischer, il faut entendre les concertos pour piano et orchestre no. 1 opus 15 et
no.2 opus 83 avec le chef George Szell et l’Orchestre de Cleveland (CBS Odyssey Y
31273 et Y 32222). Ces versions n’ont d’égales que celles du pianiste Emile Gilels
(RCA VICS-1026)) et aussi Van Cliburn (RCA Victor LSC-2581) jouant tous deux, à
tour de rôle, avec le chef Fritz Reiner et l’Orchestre de Chicago. Mais il y a aussi
la version Géza Anda avec Karajan et la Philharmonie de Berlin, quoique encore deux
versions supplantent absolument tout (y compris celles remarquables de Claudio Arrau
avec le chef Giulini tout autant que celle avec Rudolf Serkin avec encore Cleveland
et George Szell au bâton) c’est-à-dire la version du deuxième concerto avec
Svjatoslav Richter sous le chef Erich Leinsdorf et l’orchestre de Chicago (RCA
Victor 07863-56518-2) . C’est cette dernière qui reste inégalée et dont deux seuls
s’en approchent vraiment soit la version de Bruno Leonardo Gelber sous le chef
Rudolf Kempe et le Royal Philharmonic (Connoisseur society 2088 90-5773). Et, pour
compléter les lauriers de la plus haute réalisation pianistique qui soit (Brahms
n’est pas pour les gringalets fluets) notre valeureux pianiste Marc-André Hamelin
sur étiquette Hypérion offre sa version remarquable (à la hauteur des très grands
noms cités ici) avec le Dallas Symphony et le chef Andrew Litton. Tout ceci ne doit
servir qu’à illustrer combien Léon Fleischer demeure un imminent premier de classe,
acclamé et élu bien sûr parmi les dieux et déesses de la collection Great Pianists
of the Twentieth Century.
Même si la Maison Symphonique était loin d’être comble par ce bel après-midi de
reverdie et de chaleur printanière tant attendue soufflant enfin des flots de
farniente relaxant sur la métropole culturelle habituellement si agitée de notre
beau pays, ce fut un vrai plaisir de retourner au temple de notre musique pour
entendre l’orchestre symphonique de Toronto. Autre jour, autre degré d’enjouement.
En effet, les Montréalais sont constamment choyés de belle et édifiante musique: la
veille, samedi 5 mai, les vrais et nombreux mélomanes montréalais avaient eu
l’indescriptible joie irradiante de saluer la clôture magistrale, sous notre
titanesque Yannick Nézet-Séguin, d’une saison inoubliable au sein de l’Orchestre
Métropolitain, de sorte qu’à peine étions-nous remis de nos émotions de la veille
que nous voilà face à un autre orchestre de qualité. Moi qui ai connu cet ensemble
torontois au quotidien pendant plus de dix ans (1984-1994) , j’en ai reconnu la
somptuosité du quatuor à cordes lorsqu’on a la sagesse de ne pas le laisser enterrer
sous le grondement des cuivres débridés. Mais des comparaisons s’imposent et malgré
que l’OSM demeure un ensemble de toute première splendeur avec ses instruments
mirobolants qu’il reçoit de Canimex en prêt et partage, l’Orchestre métropolitain
nous semble véritablement devenu le seul et tout premier ensemble symphonique rival
à l’OSM, désormais et pour longtemps encore à surveiller considérant les immensément
grandes et émouvantes auditions musicales qu’il nous a données récemment (l’OM est
donc au minimum à parité, désormais, avec l’OSM qu’on s’en rende vite compte au
Conseil des Arts du Canada!). Le pourquoi et le comment de cette métamorphose
orchestrale mériteront des éclaircissements mais le Toronto Symphony est le
troisième orchestre de qualité au Canada.
Mon propos d’aujourd’hui est cependant de souligner le passage attendrissant de ce
pianiste fulgurant que fut Léon Fleischer. Son interprétation du concerto de Mozart
au programme avait toute la qualité des vénérables interprétations: clarté, gaieté
sémillante, une diction limpide et généreuse à l’égal de celles de Géza Anda, Maria
Jao Pires, Lili Kraus et Clara Haskil soit une beauté sonore remplie de tendresse,
d’éloquence, de discernement. Après une entrée en scène le montrant encore assez
solide sur ses jambes malgré ses 90 ans (on venait de nous le rappeler au micro par
la bouche du chef Oundjian s’exprimant dans un beau français châtié) ses débuts
d’artiste à Montréal en 1943, Léon Fleischer se penche sur la partition posée devant
lui sur le lutrin et qui n’est là qu’au cas où lui faille s’en servir. Il se tourne
vers l’orchestre et écoute les dialogues entre tous, mais le pianiste rejoue enfin
admirablement des deux mains -après tant d’années à ne pouvoir physiologiquement le
faire, des décennies pendant lesquelles il a dû se contenter de jouer des oeuvres
concertantes ou solistes pour la main gauche seule. On a bien noté quelques rares
disparités d’égalité de l’élocution, cafouillages très occasionnels du toucher mais
le plus beau demeure la personnalité expressive de chacun de ses doigts caressant
l’ivoire du clavier, un toucher d’un rare velours. En somme, le moment de son retour
était trop rare et trop inespéré pour ne pas ressentir une admiration profonde pour
le musicien persévérant et la bonhomie du chef Peter Oundjian l’accompagnant avec un
soin et une délicatesse respectueuse, tout cela d’une très haute musicalité à tel
point qu’elle doive être déclarée irréprochable.
Les 40 musiciens de l’Orchestre symphonique de Toronto déployés sur scène pour le
Mozart ont vu leurs effectifs atteindre 102 musiciens après l’entracte, car les 89
de base avaient besoin des renforts de leurs suppléants et de quelques extras (dont
2 harpistes additionnelles à la titulaire) pour interpréter la Huitième symphonie en
do mineur WAB 108 version 1887 d’Anton Bruckner. C’est la toute première version de
la symphonie non remaniée encore par le compositeur si insécure, tant intimidé par
l’avis de ses proches s’autorisant , eux, à l’influencer à tout recomposer du début.
Dans son coffret de 10 disques des symphonies de Bruckner, paru il y quelques
semaines chez Atma Classique, l’Orchestre métropolitain nous joue la version dite
Nowak de 1951, mais le plus souvent on entend la version Nowak de 1888-1889. Le
dernier mouvement de chacune de ces révisions ou refontes soit le mouvement marqué
Finale-Feierlich-Nicht Schnell reste quasiment intouché et similaire en forme et en
développement. On pourrait ergoter pendant des heures pour faire valoir une version
sur l’autre mais les refontes qui se sont déroulées durant trois années de la vie du
compositeur, au détriment de sa santé déclinante, ces refontes ont apporté de bien
substantiels ajouts de beauté tragique à l’oeuvre. Tout de même, sur le plan
comparatif, ce fut plus qu’instructif de recevoir le Toronto Symphony Orchestra en
entier dans la huitième symphonie de Bruckner proposant la version originelle (donc
avant les corrections ultérieures que je perçois absolument judicieuses, quoi qu’en
dise avec insistance l’enthousiaste chef d’orchestre Peter Oundjian) car nous avons
eu droit récemment à des exécutions par nos deux grands ensembles orchestraux, ici à
Montréal, de ces oeuvres aux contours et sonorités magnifiques. Je n’ai qu’un
reproche à adresser à l’ensemble symphonique de M. Oundjian, c’est le déséquilibre
non atténué de ses cuivres qui jouaient trop fort (et souvent faux) en enterrant
tous les pupitres de l’orchestre surtout le quatuor à cordes entier qu’on
n’entendait plus du tout en ses nuances. La Maison Symphonique permet une écoute
attentive de soi et l’ensemble torontois se précipitait trop sans attendre la fin
des réverbérations en ces espaces splendides qui font toute la merveille acoustique
de notre salle véritablement unique au pays. J’ajoute à cela, hélas, la faiblesse
des bois du TSO à exprimer la beauté quintessencielle de leurs solos, trop noyés
comme ils l’étaient dans la masse sonore (cela ne peut être imputable à la version
de l’oeuvre jouée très rarement et pour cause fort défendable d’ailleurs car les
versions remaniées sont plus riches rythmiquement et en textures considérant que ce
sont les mêmes idées musicales dominantes qui circulent dans toutes ces versions de
la huitième). Il est vrai que les merveilleux solistes tant des vents de l’Orchestre
métropolitain que de l’OSM (et ça ce n’est pas ici une nouvelle) éclairent et
insufflent une énergie lumineuse telle à la musique de Bruckner qu’il est injuste
pour nous d’exiger cette authentique intensité ou de s’attendre à une telle
intensité comme excellence minimale chez nos visiteurs, mais l’écart de rendement
était trop manifeste pour que je ne le passe pas tout à fait sous silence . De tout
ceci, il découle que des correctifs urgents doivent être apportés au palmarès de
nos orchestres symphoniques et qu’on rende avec justesse et justice les subsides,
soit le fruit des moissons musicales nouvelles au Canada. Pour le TSO, être bon
troisième dans un tel contexte d’excellence n’est pas une honte, loin de là. Nous
vivons l’âge d’or de la musique classique au Canada (par la qualité de nos ensembles
et de nos interprètes) et peu de gens parmi nous semblent s’autoriser à devoir le
reconnaître.