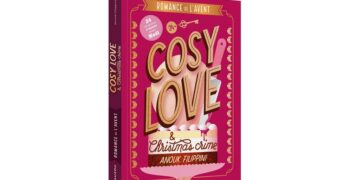Albert Camus, avant de devenir l’un des penseurs les plus lumineusement intègres du 20e siècle, a été un jeune homme épris d’absolu. Avec la fougue d’un héros romantique qui aurait volé à Nietzsche l’envie impérieuse d’aller voir au-delà du bien et du mal, il entreprend à vingt-cinq ans l’écriture d’une pièce où il prête au personnage historique de Caligula une volonté folle: celle de s’affranchir de toute entrave à ses désirs. Et comme Camus souhaitait que l’on évite le « style romain », le metteur en scène René Richard Cyr situe la fiction de Camus dans un monde qui évoque le nôtre, où le mot liberté est trop souvent détourné pour en faire un étendard des pires dérives individualistes.
Caligula, le jeune empereur de Rome, a disparu. On s’inquiète: la mort de sa sœur et amante Drusilla l’a-t-elle poussé au désespoir ? Mais le voici qui revient clamant que « ce monde, tel qu’il est, n’est pas supportable ». Il met alors tout son pouvoir et toute son intelligence à faire advenir l’impossible ; obsédé par la médiocrité des vies ordinaires et fasciné par l’horreur arbitraire des catastrophes, il se lance dans la perversion systématique de toutes les valeurs afin de comprendre jusqu’où peut aller l’exercice absolu de la liberté. Déterminé à vivre sans aucune contrainte, que découvrira-t-il au fond de lui-même ?
Autour de l’exceptionnel Benoît McGinnis en Caligula, René Richard Cyr a réuni une assemblée d’actrices et d’acteurs qui sait faire résonner le verbe de Camus, où l’on retrouve entre autres l’admirable Macha Limonchik.
ARGUMENT Au palais impérial romain, les patriciens s’inquiètent: où est Caligula? Voilà trois jours que l’empereur a disparu. On le présume bouleversé par la mort de Drusilla, sa sœur bien-aimée — et son amante. Mais lorsque le jeune homme reparaît, il tient un étrange discours, réclamant la lune, c’est-à-dire l’impossible. C’est que le maître suprême de l’Empire romain a pris conscience de son impuissance fondamentale : «Les hommes meurent et ils ne sont pas heureux.» Une vérité désespérée dont Caligula va refuser de s’accommoder. Au contraire. Dans sa révolte, il va tenter d’en pousser les conséquences jusqu’au bout de leur logique. Désormais, avec le concours de l’amoureuse Cæsonia et du fidèle serviteur Hélicon, l’empereur va s’employer à exercer une liberté sans limite, forçant ses sujets à vivre «dans la vérité »: celle d’un monde absurde où la vie n’est rien et où la mort frappe de façon arbitraire. Trois années plus tard, les nobles n’en peuvent plus du traitement despotique que le fantasque Caligula leur inflige. L’empereur les ridiculise, confisque leurs biens, enlève leur femme, fait exécuter leurs proches. Sans compter qu’il révèle leur hypocrisie en prenant au mot leurs paroles flatteuses. Les lâches patriciens agissent en effet servilement en la présence du tyran, tout en complotant dans son dos. Prévenu de la conspiration, Caligula en confronte le meneur, le lucide Cherea. Mais plutôt que de le sanctionner, il détruit la seule preuve qui l’incrimine. L’empereur sait que sa quête nihiliste approche de son terme inévitable et reconnaît l’échec de sa démarche libertaire. Frappé de toutes parts, Caligula meurt en lançant un dernier défi à la mort.
Caligula et cycle de l’absurde
Entre la fin des années trente et le début des années quarante, soit cette période trouble qui voit le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, Albert Camus entreprend ce qu’il considère comme «le premier stade de ce que maintenant je n’ai pas peur d’appeler mon œuvre». Il a déjà publié en 1937 un premier livre, L’Envers et l’endroit, paru à 350 exemplaires en Algérie. Mais c’est sa période explorant l’«absurde», croit-il, «qui décidera de tout le reste». Trois ou quatre œuvres à part entière, composées en parallèle et dans autant de genres littéraires différents: le théâtre (Le Malentendu suivi de Caligula, cette publication est d’abord associée à l’étape suivante, celle consacrée à la révolte: La Peste, Les Justes, L’Homme révolté), le roman (L’Étranger) et l’essai (Le Mythe de Sisyphe). La suite donnera raison à Camus; l’édition des deux derniers livres, en 1942, alors qu’il n’a même pas trente ans, le consacre comme un écrivain important. LE MYTHE DE SISYPHE Dans Le Mythe de Sisyphe, l’essayiste définit la « sensibilité absurde » comme un divorce irrémédiable entre le désir de sens qui anime les êtres humains et l’irrationalité, l’indiffé- rence que leur oppose le monde. Le penseur y critique certains philosophes existentiels qui, devant ce «mal de l’esprit» dont souffrent leurs contemporains, proposent comme solution la croyance en Dieu. Pour Camus, ce faux espoir n’est qu’une fuite face à la réalité de la condition humaine. Il prône au contraire de vivre en toute lucidité dans ce monde sans lendemain: l’absurde, écrit-il, est «l’état métaphysique de l’homme conscient». Seul «problème philosophique vraiment sérieux », décrète-t-il en ouverture de l’essai, le suicide n’est pas davantage une réponse à notre existence dans un monde dénué de sens. L’écrivain tire plutôt, comme conséquences de l’absurde, une passion pour la vie, la liberté de savoir que notre destin nous appartient et la nécessité d’une révolte constante, qui confère sa « seule dignité » à l’être humain.
ENTRETIEN AVEC RENÉ-RICHARD CYR
En 1993, vous avez mis en scène Le Malentendu de Camus au TNM.
J’imagine que vous entretenez un rapport particulier avec cet auteur? Comme plusieurs étudiants de ma génération, c’est un auteur que j’ai découvert avec L’Étranger, quand j’étais au secondaire. Je me suis souvent penché sur son œuvre. J’ai d’ailleurs toujours l’œil sur son adaptation des Possédés de Dostoïevski et sur Les Justes, que j’adore. Je connaissais Caligula, que j’avais vu mis en scène brillamment par Brigitte Haentjens. Mais étonnamment, ce projet ne s’est pas enclenché de la même façon que d’habitude. Il est venu de Benoît McGinnis qui désirait que je monte la pièce avec lui. C’est l’acteur avec lequel j’ai le plus travaillé et nous avons un rapport privilégié. Mais cette fois, ce n’est pas moi qui suis allé le chercher, mais lui qui est venu à moi; c’est touchant.
Qu’est-ce qui vous a frappé à la relecture de Caligula? La qualité du texte, les questions qu’il pose. J’ai eu envie de porter sur scène ces mots-là. Et je pense qu’il y a encore des éléments de réflexion extrêmement troublants dans la pièce. Sur les limites de la liberté, par exemple. Un peu comme j’avais fait pour Le Balcon de Genet, ma proposition pige aux multiples versions existantes de la pièce. J’ai supprimé certains éléments relevant de procédés dramatiques novateurs à l’époque de l’écriture, mais qui me semblaient vieillots aujourd’hui. À l’inverse, j’ai réintégré dans la pièce des répliques issues de versions antérieures, que Camus avait biffées par la suite.
Quelle vision avez-vous du personnage-titre?
Je ne sais pas ce que j’en penserai demain, mais aujourd’hui je crois que c’est un héros tragique. Il souffre et il va pousser sa quête d’absolu jusqu’à l’extrême de sa logique, en hypothéquant la liberté des autres. Pour moi, la pièce est l’histoire d’un suicide. C’est comme si Caligula disait à son entourage : «jusqu’où allez-vous accepter que je me rende dans l’horreur avant de vous soulever ? Mais allez-vous donc me tuer! Je n’ai pas le courage de le faire moi-même.» Il tente aussi de donner un sens à sa mort afin qu’elle apprenne quelque chose à l’humanité. En même temps, la pièce parle d’amour. Moi qui suis un indécrottable romantique, je considère qu’il y a un romantisme très fort chez Caligula. Le point de départ, l’événement fondateur, est quand même la mort de sa sœur Drusilla dont il est amoureux. Et ce qui est inacceptable pour lui, ce qui rend sa vie dépourvue de sens, ce n’est pas tant le décès de l’être aimé, mais de savoir qu’il va oublier sa mort. Elle est morte, je vais manger ce soir et je vais dormir cette nuit… Alors j’ai ajouté le personnage de Drusilla dans le spectacle. Elle y apparaît comme le fantôme, non pas simplement d’un amour perdu, mais du bonheur, du moment où sa vie allait bien. Le fantôme du paradis perdu. Je ne veux pas non plus expliquer tous les gestes que Caligula va poser par la perte de son amour, parce que ce serait faux. La pièce traite de la condition humaine, telle une autopsie du vertige de vivre. Et il ne s’agit pas de réhabiliter le personnage. Juste d’oser reconnaître que le désespoir peut transformer n’importe quel être humain et que cette faculté de devenir un loup pour l’Homme, on l’a tous en nous. La grille romantique que je vois dans la pièce tient aussi à la jeunesse de Camus lorsqu’il l’a écrite et à la dimension nietzschéenne du protagoniste. Il y a chez lui un refus très adolescent du pouvoir établi tel qu’il est. Je lis tout ça dans Caligula. © Jean-François Gratton Caligula 89
Camus a écrit que Caligula était le seul tyran, à sa connaissance, à «avoir tourné en dérision le pouvoir lui-même»…
C’est très moderne, ce cynisme envers le pouvoir. C’est pourquoi j’aime imaginer que Caligula était bienveillant avant la mort de Drusilla. Plusieurs personnages soulèvent qu’au début de son règne il était un bon empereur, plutôt heureux même. Les aristocrates voulaient qu’il soit un pantin, alors qu’il devient plutôt le marionnettiste… Si on regarde l’histoire du vrai Caligula, il a été un despote pour l’aristocratie de son époque, mais jamais pour le peuple. C’est l’autorité qu’il a attaquée. Dans les premières versions de Caligula écrites par Camus, les patriciens s’appelaient d’ailleurs des sénateurs. Je leur ai redonné ce titre et j’ai offert certains des rôles de sénateurs à des comédiennes, de façon à ce que le pouvoir soit plus moderne. Je trouvais aussi intéressant d’ajouter ce rapport à la féminité dans une pièce où il n’y avait que des hommes, à l’exception de la maîtresse de l’empereur, Cæsonia. Empoisonner une sénatrice, ce n’est pas comme empoisonner un sénateur…
Comment envisagez-vous la production?
Je ne pense pas que l’œuvre de Camus puisse supporter une mise en scène très élaborée. Ce sont les mots qui doivent être mis en avant. Je trouve que c’est un texte formidable à lire, alors je vais essayer qu’il ne soit pas noyé sous les fioritures. J’ai le goût de mettre en valeur le sens de ces mots, de pousser la réflexion du spectateur. Quand j’ai relu Caligula, je ne pouvais arrêter de penser au décor que j’avais créé avec Pierre-Étienne Locas — un scénographe qui m’allume beaucoup et avec qui je travaille régulièrement — pour l’opéra The Turn of the Screw, un des spectacles dans mon parcours dont je suis très fier. C’était un vaste mur, percé de petites interstices, et tout se jouait sous ce mur, ce qui donnait l’impression qu’on jouait dans une cave. On n’a évidemment pas reproduit le même décor ici, mais cette idée nous a servi de point de départ. Caligula frappe un mur.
Comment concevez-vous votre liberté de metteur en scène par rapport à un texte de répertoire?
Je me suis toujours permis à la fois un énorme respect et un énorme irrespect envers le répertoire. Je n’ai jamais osé écrire à la place d’un auteur. Mais le théâtre est un art vivant, ce qui nous donne le droit de mettre en lumière les éléments d’une pièce qui nous semblent les plus actuels. Le pire qui pourrait arriver, c’est que les idées que je partage avec vous aujourd’hui se retrouvent transposées de manière fidèle sur scène lors de la création du spectacle ! Parce que ça signifierait qu’elles n’auraient pas évolué. Si je sais comment faire quelque chose, alors ça ne m’intéresse pas : je l’ai déjà fait! Mettre en scène un spectacle, c’est arriver en répétitions tellement préparé qu’on est prêt à tout changer ce qu’on avait prévu. Et en entendant les acteurs interpréter un texte, on a parfois de grandes surprises.
PROPOS RECUEILLIS ET MIS EN FORME PAR MARIE LABRECQUE, MARS 2016