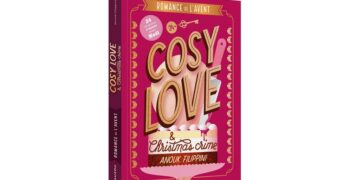Nous sommes tellement habitués de savourer un très haut niveau d’interprétation musicale avec l’OSM (surtout ses instruments à cordes fabuleux prêtés par de dévoués mécènes) et nous avons un tel chef en Yannick Nézet-Séguin qui a transfiguré l’Orchestre Métropolitain en orchestre majeur aux interprétations émouvantes et phénoménales que nous avons pu percevoir, jeudi soir 5 avril, à quel point nous sommes gâtés.
On a immédiatement mesuré toute la distance qu’il y a entre le monde musical canadien anglais et celui si dynamisant englobant tout le Québec. Je parle de cette ferveur qui fait chaque soir vibrer la Maison symphonique et tout Montréal. Je dois souligner avec franchise tant pour la justice de l’appréciation de la valeur musicale réelle des ensembles orchestraux au Canada que pour l’apport financier qui doit s’ensuivre en termes de subventions méritées, que l’Orchestre du Centre national des Arts n’a pas même le niveau d’excellence technique ni le niveau d’interprétation que ceux de l’Orchestre symphonique de Québec dirigé par Fabien Gabel. Même si l’OSM avait en effet prêté son précieux Timothy Hutchins (le fabuleux flûtiste solo de notre ensemble) à l’orchestre ottavien du chef Alexander Shelley ce jeudi soir 5 avril, cela n’a guère fait de différence ni dans le Brahms ni dans le Schumann, et donc pour aucune des interprétations des oeuvres au programme puisque le reste de l’ensemble imposait à tout moment sa vraie couleur.
La pianiste Béatrice Rana, cette grande gagnante du concours international de musique de Montréal (qui ne mentionne pas un mot – en tout cas dans sa biographie d’artiste offerte au programme – de sa médaille d’argent au fort prestigieux Concours Van Cliburn en 2013…) est celle qui a le plus souffert de la lourdeur expressive des cuivres de l’orchestre, notamment de ces entrées peu à point, souvent mal coordonnées entre tous les pupitres de tout l’ensemble. L’interprétation courageuse qu’elle a voulu donner du Concerto pour piano et orchestre en ré mineur de Johannes Brahms opus 15 rejoint quand même, au bout du compte, celles des valeureuses femmes interprètes telles Hélène Grimaud et Gina Bachauer qui se sont attaquées avec courage et un certain succès à Brahms (le deuxième concerto demeure un obstacle quasi infranchissable, pas le premier).
Exigence fondamentale, la projection du son est de loin le défi le plus difficile pour celles qui suivent les traces de Clara Schumann, l’épouse dévouée de Schumann qui s’est évertuée jusqu’à la fin de sa vie à faire connaître le compositeur allemand natif de Hambourg, devenu son ami en 1853, tout autant que les oeuvres de son malchanceux mari. Mademoiselle Rana dispose toujours d’une grande fougue et d’une technique éblouissante. On l’a observée, de dépit de voir les choses mal avancer, devoir bousculer l’orchestre au premier mouvement et encore davantage au troisième mouvement, mais c’est son interprétation magistrale du second mouvement marqué Adagio qui fut le clou de cette soirée tant attendue.
La pianiste nous a généreusement offert aussi avec la tendresse qu’on lui connaît, sur le piano Steinway très désaccordé et très éprouvé, le princier treizième prélude en Fa dièse majeur de Frédéric Chopin avec une intimité et une délicatesse expressive inoubliables et cela même en dépit que le piano chantait faux comme s’il avait 175 ans de vieille vie expressive. Béatrice Rana, Italienne, a remercié ensuite d’un beau sourire et de ses lèvres sémillantes le public montréalais en français, toujours élégante comme on l’a connue, sans colère de ne pas être plutôt présentée avec l’OSM, incontestablement racée comme le fut dans sa jeunesse la grande et incomparable Alicia de Larrocha pour qui veut bien se souvenir de cette pianiste immense qui n’eut d’égal que Claudio Arrau, Svjatoslav Richter et Artur Rubinstein. Mademoiselle Rana mérite donc de jouer ce concerto de Brahms avec de grands orchestres. Dans quinze ans, quand il aura mûri sous ses doigts et au plus profond de son coeur, elle l’enregistrera peut-être pour s’inscrire aux côtés de la version Fleisher-Szell-Cleveland (Columbia Odyssey Y31273).
Au retour de l’entracte, avec une distinction cauteleuse, une élégance raffinée d’Anglais sophistiqué et cultivé, Monsieur Alexandre Shelley a pris le micro pour s’exprimer: dans la seule langue de Molière, il a fait mention de sa joie d’être réinvité à la Maison Symphonique et cela dans un français impeccable (tant du point de vue de l’exactitude des accords en genre et en nombre que de l’usage des temps et modes verbaux en conjugaisons bien maîtrisées et je ne parle pas ici, en plus, de la clarté des accents syllabiques pertinents portés sur la fin de chacun des mots qu’il choisissait avec pertinence et une sincère émotion).
Cet aveu de joie d’être à la Maison Symphonique nous a fait songer encore une fois que l’orchestre qu’il dirige a besoin, pour s’améliorer, d’une Maison Symphonique digne de ce nom, à Ottawa, là où l’ensemble puisse s’écouter et s’entendre vraiment jouer comme il joue, car ce n’est pas tout de se déchaîner pour jouer vite et avec une fougue apparente que des quidams puissent déclarer renversante. Ainsi, la deuxième symphonie de Schumann dirigée de mémoire par M. Shelly a connu bien sûr quelques moments d’entrain mais les cuivres ont cette accablante lourdeur et cette fausseté des ensembles de second ou troisième niveau. Sans Hutchins, les flûtes et les bois eussent été encore plus ternes (on n’avait pas un Théodore Baskins non plus au hautbois ni d’équivalent à la clarinette). Les lancinantes mélopées du quatuor à cordes qui manque de souffle en émouvante profondeur sont aussi le symptôme de ce qui doit être encore travaillé (comme le fit avec acharnement sur les musiciens de l’orchestre Franz-Paul Decker soit avec l’OSM en travaillant la musique allemande durant les années soixante-dix… et on sait combien un jadis vénéré disciple d’Ansermet comme l’était Dutoit a su faire valoir et briller la musique française, enfin… beaucoup de pain sur la planche pour l’orchestre d’Ottawa qui doit d’abord songer à se munir d’une salle digne d’une dite grande nation pour bien s’entendre et s’écouter jouer).
Certes, le jeune chef anglais a hérité de la direction de l’ensemble du virtuose et ancien directeur artistique Pinchas Zukerman, il y a deux ans et demi environ : on peut peut-être exprimer aimablement qu’il tient habilement ce qu’on appellerait poliment les rênes de l’Orchestre national des Arts. Mais, pour avoir entendu régulièrement cet orchestre depuis dix ans environ durant mes nombreuses pérégrinations dans la capitale du Canada, je ne puis dire qu’il ait fait réaliser réellement un immense progrès sur le plan musical, en tout cas certainement pas celui qui fait dire des choses extravagantes et mercantiles, tout-à-fait des vantardises bien trop élogieuses et très exagérées via un ou deux journalistes du Macleans et du Ottawa Citizen (voyez les biographies du chef et le récapitulatif de l’ensemble publiés au programme). Ceux-ci vantent avec forfanterie l’Orchestre national des Arts sauf pour sa juste et valeureuse vocation de diffusion de la musique classique d’un océan à l’autre. Cela ne veut pas dire que l’orchestre soit mauvais, que l’on ne se méprenne pas, car il faut être compréhensif et atténuer notre jugement du fait que l’orchestre du CNA est tenu de s’entendre jouer à la salle Southam (d’horrible acoustique étouffée et suffocante, malgré tous les pansements posés aux murs et plafonds de lourd béton).
Cette tombe musicale finit par éteindre la flamme intérieure et quand, en plus, on n’a pas au quotidien la joie de vivre à l’allégresse de la flânerie montréalaise qui insuffle à l’âme ce je ne sais quoi d’envol volontiers, cet emprisonnement musical au désormais diaphane Centre national des arts (on l’a rendu plus transparent à la lumière grâce au verre assez translucide du moins en sa façade septentrionale), il faut comprendre que la réverbération intérieure nécessaire au retentissement des mélodies dans l’âme du poète suprême qu’est un musicien, que ces manques-là handicapent les disciples d’Orphée, à la longue… Tout de même, il serait inexact de conclure que la soirée fut désagréable, loin de là, sauf que nous sommes habitués à avoir, tout le temps, tellement mieux. Ce furent donc un ensemble d’assez bons moments, sans plus et Béatrice Rana saura faire tonner, gronder, tempêter et langoureusement gémir mieux encore ce Brahms athlétique pourvu qu’intervienne un ressourcement qu’offre la maturité, ce vernis conféré par les épreuves du temps. Un tel cheval de bataille que le premier concerto pour piano et orchestre de Brahms doit être monté bien des fois pour être dompté avec la force herculéenne qu’il exige. Ce n’est pas un palefroi (cheval de parade des monarques) mais un destrier (cheval de guerriers). Aux armes, citoyenne Rana!